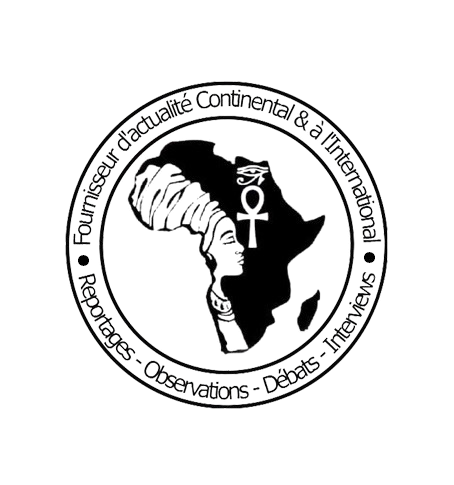La piraterie recule dans le Golfe de Guinée, mais les trafics s’adaptent et la gouvernance reste fragmentée. Entre ambitions politiques et réalités portuaires, la sécurité maritime demeure le talon d’Achille de la compétitivité des ports africains.
À Lomé, la Maritimafrica Week, qui s’est tenue du 10 au 12 septembre 2025, a réuni acteurs publics, experts et opérateurs du secteur maritime.
L’événement a mis en lumière l’urgence d’agir face aux défis de la sûreté en mer. En parallèle, l’expérience camerounaise de PortSec illustre, en dehors du sommet, un modèle opérationnel qui fonctionne.
Lors du panel consacré à la sécurité maritime, le lien entre sûreté portuaire, compétitivité économique et souveraineté des États a été mis en avant. Les intervenants ont rappelé que ces objectifs restent fragilisés par des dépendances extérieures et des dispositifs locaux encore insuffisants.
Reste à transformer les intentions en capacités. Entre financements dispersés, coopération régionale à parfaire et dépendances extérieures à réduire, l’Afrique maritime joue aujourd’hui sa crédibilité économique.
À défaut, les terminaux modernisés risquent de devenir des passoires coûteuses plutôt que des moteurs de compétitivité.
Ambitions africaines et dépendances extérieures
Face à ces défis, les États africains affichent leurs ambitions. La Charte de Lomé sur la sûreté et la sécurité maritimes de 2016 qui devait marquer un tournant décisif et sa mise en œuvre restent incomplètes.
Quant à la Charte du transport maritime de l’Union africaine, elle n’est entrée en vigueur qu’en 2025, quinze ans après son adoption, symbole d’une inertie persistante.
Dans ce contexte, certains pays avancent seuls. Le Maroc a massivement modernisé ses garde-côtes et intensifié sa coopération avec l’Union européenne et les États-Unis, se plaçant « à l’avant-garde » de la sécurité maritime africaine.
Cette stratégie montre qu’investir dans la sûreté n’est pas un coût mais un levier d’attractivité. Pour de nombreux experts, la sécurité portuaire demeure « l’impératif oublié de l’attractivité ».
Les investissements se concentrent sur l’extension des terminaux et l’optimisation logistique, reléguant souvent au second plan la sûreté, pourtant décisive pour sécuriser et stabiliser les flux commerciaux. « Sans réformes judiciaires et sans application effective du droit en mer, la lutte contre la criminalité maritime restera inachevée », alerte le think tank indépendant Le Rubicon, spécialisé dans les questions de défense, de sécurité et de droit international.
Le Golfe de Guinée, façade sous tension
Avec ses richesses halieutiques et pétrolières, le Golfe de Guinée concentre tous les paradoxes : un potentiel économique immense, mais des menaces persistantes. Piraterie, trafics de drogue, siphonnage de pétrole, contrebande et pêche illégale structurent une économie criminelle qui mine les États riverains.
Si les attaques ont reculé, de 26 en 2019 à 6 en 2024 selon le MICA Center, c’est au prix d’une militarisation croissante et d’initiatives régionales comme l’Architecture de Yaoundé. Cependant, la gouvernance reste fragmentée : droit de poursuite mal appliqué, rivalités de souveraineté et lenteur des ratifications.
À Lomé, lors de la Maritimafrica Week 2025, ce constat a été replacé dans le cadre plus large de l’économie bleue. La capitale togolaise, vitrine régionale avec son port en eau profonde, veut se positionner comme hub logistique et financier. Mais, la question sécuritaire s’impose comme un verrou : un port exposé aux trafics perd en attractivité et fragilise la souveraineté nationale.
Sécurisation portuaire
Dans ce contexte, le projet conduit par PortSec SA à Douala offre un exemple concret de sécurisation portuaire. Depuis 2019, l’entreprise déploie le programme Douala Port Security (DPS), qui associe surveillance par drones, radars longue portée, contrôles biométriques et formations spécialisées.
Les chiffres disponibles font état d’une baisse d’environ 35 % des vols de marchandises entre 2019 et 2023 et d’une coordination régionale renforcée dans le cadre de l’Architecture de Yaoundé.
Cette expérience camerounaise soulève une question plus large : comment transposer ce type de dispositif dans d’autres ports africains aux réalités institutionnelles et financières très différentes ?
Le modèle développé par PortSec montre qu’une combinaison d’outils technologiques, de formation et de coopération régionale peut améliorer la sûreté et renforcer la crédibilité logistique d’une plateforme.
L’enjeu n’est plus tant la pertinence du modèle que les conditions de son adaptation à l’échelle du continent. Et ce, dans l’optique d’avoir un espace maritime sécurisé qui offre tout son potentiel pour le développement du continent.